 Présentation de l’éditeur : « Je voulais comprendre comment Lorca Horowitz avait mis en place son plan d’anéantissement sans éveiller le moindre soupçon, et avait osé monter une à une, sans jamais reculer ni même hésiter, les marches qui la menaient droit à son crime. Je voulais comprendre pourquoi elle l’avait fait. Mais surtout en quoi cela me concernait, me touchait. Qu’avais-je à voir là-dedans ? »
Présentation de l’éditeur : « Je voulais comprendre comment Lorca Horowitz avait mis en place son plan d’anéantissement sans éveiller le moindre soupçon, et avait osé monter une à une, sans jamais reculer ni même hésiter, les marches qui la menaient droit à son crime. Je voulais comprendre pourquoi elle l’avait fait. Mais surtout en quoi cela me concernait, me touchait. Qu’avais-je à voir là-dedans ? »
Éditions Stock – 216 pages
Depuis le 30 décembre 2015 en librairie.
Ma note : 4,75 / 5
Broché : 18 euros
Ebook : 12,99 euros
Dans Appelez-moi Lorca Horowitz, le nouveau roman d’Anne Plantagenet, le mystère s’installe dès la couverture hypnotique, véritable invite à en savoir davantage sur cette jeune femme séduisante et séductrice, pas vraiment belle mais sophistiquée, manifestement sûre d’elle et un soupçon insolente, provocante, dans sa manière de fixer le lecteur dans le blanc des yeux. Une curiosité d’autant plus exacerbée à la lecture du prière d’insérer qui fait état d’un crime qu’elle aurait commis…
Et d’en découvrir les circonstances durant les quelque deux cents pages de ce roman à l’orée du thriller psychologique post–roman noir, alternant le récit de la protagoniste éponyme et d’une narratrice fascinée par le fait divers survenu à Carmona en Espagne sur lequel elle décide de mener l’enquête pour découvrir ce qui se cache derrière ce personnage redoutable ayant décidé de vampiriser la vie d’une autre.
Comme Florence Noiville qui décrit le syndrome de Clérambault dans L’illusion délirante d’être aimé, Anne Plantagenet construit une histoire fascinante autant que terrifiante autour d’une psychotique ; occasion donnée d’une exploration des mécanismes de la mythomanie, du clivage du moi ou de la schizophrénie et de l’usurpation d’identité. À la différence que si l’on constate une forme perverse du mensonge dans l’intention de tromper en vue de son intérêt personnel et un délire entre déni du réel et lucidité, la pathologie psychiatrique de Lorca n’est en l’occurrence jamais clairement définie.
L’auteur brosse donc le portrait inquiétant d’une femme énigmatique qui, guidée par sa fixation, va, à force d’efforts drastiques obsessionnels sur elle-même et de basses manœuvres, se transformer d’une petite boulotte mal fagotée, serviable, anonyme et fauchée en belle et riche créature magnétique et toxique. De la chenille au papillon. La narration met progressivement en évidence comment elle fait de la vie du couple d’architectes l’ayant prise sous son aile – une famille évidemment modèle à la réussite sociale exemplaire selon la volonté la plus récurrente des mythomanes d’en imposer -, un enfer. En particulier de l’épouse dont, entre admiration et jalousie, elle va s’inspirer, poussant le mimétisme jusqu’à son paroxysme, usant de toutes les machinations pour devenir elle et l’évincer, acculant aux limites psychiques les plus extrêmes son modèle souffre-douleur qui, comme souvent dans ce cas, bien que victime, est accusée de paranoïa, doit faire face à l’isolement orchestré par son bourreau et se retrouve incitée au pire par désespoir. Jusqu’à quand ? Jusqu’où ?
Entre les nombreux mystères entourant la vie réelle de l’héroïne machiavélique dévoilés à petites touches malgré une part d’ombre permanente et le calvaire enduré par sa proie, se dessine une atmosphère étouffante. D’autant plus oppressante qu’à l’instar de l’enquêtrice dilettante, l’identification inévitable à la faussaire, imposteur, usurpatrice, mystificatrice, est de plus en plus dérangeante. Le lecteur se surprend à éprouver de l’empathie d’avec la criminelle parce que les raisons qui l’ont faite basculer le renvoie immanquablement à son propre vécu. À ces pensées qui existent dans l’esprit de tout un chacun et y restent heureusement pour le plus grand nombre, liées à ce moi anarchique tout puissant et désinhibé. La différence résidant dans le passage à l’acte. Si l’on ajoute à cela sa condition faite de misère matérielle et émotionnelle ainsi que divers traumatismes, le mensonge de Lorca, bardé de circonstances atténuantes, apparaît finalement moins comme une envie de tromper l’autre que l’unique dispositif de survie à sa portée, sa seule chance d’avoir une identité valable.
Là est toute la force de cette investigation littéraire des conséquences dramatiques d’une névrose dissociative : le parallèle troublant entre la criminelle, la narratrice et le lecteur. Roman déroutant et envoûtant à l’ambiance hitchcockienne, il est résolument réussi. La dynamique de chapitres courts et la plume ciselée levant avec une subtile mesure le voile sur les secrets pour renforcer le suspense incitent à une lecture frénétique. Cette remontée aux sources d’une tragédie inaugure avec brio la rentrée littéraire d’hiver et met en évidence cette désolante réalité suivant laquelle l’attention se porte quasi systématiquement davantage si ce n’est exclusivement sur le coupable plutôt que sur la victime, l’intérêt allant croissant proportionnellement au degré de perversité du responsable du forfait. Voyeurisme quand tu nous tiens…
Vous aimerez sûrement :
Là où tombe la pluie de Catherine Chanter, Amelia de Kimberly Mc Creight, Avant d’aller dormir & Une autre vie de S. J. Watson, La vie d’une autre de Frédérique Deghelt, La fille américaine de Monica Fagerholm, À moi pour toujours & Les revenants de Laura Kasischke, Un passé en noir et blanc de Michiel Heyns, Le complexe d’Eden Bellwether de Benjamin Wood, Roman de l’au-delà de Matthias Politycki, Barracuda de Christos Tsolkias…
Extraits :
Ce n’est pas difficile, les gens sont là pour être aimés, ont besoin qu’on les flatte et leur dise ce qu’ils ont envie d’entendre, c’est le principe des horoscopes. Je connais bien le sujet parce que je m’amuse à en rédiger dans ma tête pour me détendre, même que je favorise systématiquement le signe des Gémeaux qui est le mien et n’a pas toujours eu la faveur des astres avant que j’intervienne et rééquilibre les choses, il faut vraiment tout faire soi-même. Les gens, ils veulent de l’espoir et du compliment, ça les attendrit.
…
Qui n’a pas imaginé un jour disparaître totalement, s’extraire d’une vie décevante très éloignée des promesses qu’elle tenait à l’aube, faire croire à sa mort et se payer une deuxième chance à un autre endroit de la planète, à des milliers de kilomètres, sous un nouveau nom ? Tout plaquer, couple, enfants, boulot, refuser un chemin balisé, sans surprise, imposé par je ne sais quels déterminisme, conventions, milieu social, fausse égalité en droits, et tracer sa propre route, rectifier soi-même la répartition des dons à la naissance ? Nous y songeons tous, à des périodes de tunnel comme l’existence oblige parfois à en traverser, de trahison, chagrin, deuil, angoisse, nous caressons secrètement cette idée et elle nous réconforte pendant un temps car il faut bien s’accrocher à quelque chose, se projeter ailleurs, même si ce n’est qu’en pensée, même si on sait bien sûr qu’on ne le fera pas pour de vrai.
…
L’histoire de Lorca Horowitz puisait peut-être son énergie dans une rébellion, elle avait pris sa source dans une douleur devenue tellement insupportable qu’elle avait débordé. C’est sans doute ce qui fascine dans les faits divers, ils sont le spectacle, donné par d’autres, de nos pires divagations, de nos utopies les plus condamnables, ils bafouent notre censure. L’inconscient du fait divers rejoint le nôtre, notre rêve secret d’anarchie. Dans celui de Lorca Horowitz, avait pris place de manière très naturelle la possibilité d’inverser l’ordre établi. Elle ne croyait pas au miracle, à le pensée magique, aux dons soudain tombés du ciel, au génie qui surgit d’une lampe à huile, elle savait qu’elle ne pouvait pas compter sur l’espoir. Elle ne pouvait compter que sur elle.
…
Petite, le soir, dans mon lit avant de dormir je m’étais toujours inventé des histoires dont j’étais l’héroïne adulte. J’avais imaginé des centaines de scénarios possibles de l’avenir. J’avais décidé que j’aurais une vie dérangée, une vie bruyante et malheureuse. C’était l’idée que je me faisais du contraire de l’ennui, qui était ma plus grande épouvante, et j’ai toujours fait du mieux que j’ai pu pour le tenir à distance. Pas question d’étriquer mon existence, de l’assiéger avant l’heure, pas question qu’elle devienne immobile, que se succèdent les résignations silencieuses, les contrats signés avec le désenchantement, je voulais l’écrire en grand, avec de l’inconfort et du mouvement, des drames amoureux, du recommencement permanent. J’ai toujours su qu’il me serait très difficile de rencontrer un homme qui comprendrait ça, qui partagerait cette apologie du roulis avec moi pour les siècles des siècles. J’ai l’ai cru et tenté tout de même, à plusieurs reprises, parce que chaque fois que je tombe amoureuse c’est toute entière, de manière exclusive et fidèle, j’ouvre tous les champs des possibles, ne demandant qu’à voir mes certitudes s’effondrer. Et même si la beauté de l’histoire ne peut être jugée à sa durée, pas plus qu’une oeuvre d’art au temps que l’artiste a passé à la réaliser, je me suis toujours lancée dans l’amour sans fixer de limites, elles viennent bien assez vite toutes seules. Je me suis cognée dedans, souvent, douloureusement.
Je n’ai pas rencontré cet homme, j’ai écrit des livres. Et en 2013, quand j’ai découvert l’affaire Lorca Horowitz, il m’arrivait de me dire que je finirais peut-être mes jours dans un manoir en Cornouailles, au coeur d’un décor brutal, sans cesse livré aux intempéries, seule, absolument, face à la mer. Ce n’était pas une vision d’échec, ni de réussite, puisque je n’ai jamais placé la vie ou l’amour sur le terrain de la performance. La solitude est mon baume. C’est mon baume et ma chaîne, je me suis empêtrée dans cette contradiction depuis très longtemps, désir de stabilité conventionnelle d’un côté, mari enfant maison, besoin irrépressible de prendre le large de l’autre.…
Ça paraît tellement simple qu’il serait tentant de s’emballer, de passer un cran au-dessus. C’est justement l’erreur que commettent ceux qui confondent l’ambition et la gourmandise. Ne pas se faire prendre donne un sentiment d’impunité très grisant mais très trompeur et moi, en ce moment, je me fais violence pour rester humble.
…
Pourtant, j’étais convaincue qu’on ne repartait pas de zéro. On ne refaisait pas sa vie, on la continuait, autrement, d’acte en acte. J’avais poursuivi la mienne dans un nouveau décor, avec un costume différent, mais aussi radicale que j’avais été, il y avait bien quelque chose de moi qui n’avait pas dû changer. Je ne croyais pas possible de tout renier. Cela aurait été comme plonger dans un puits sans fond, s’abîmer à jamais, sans aucune possibilité de se retenir à quelque chose. Il y avait bien toujours un geste qu’on gardait malgré soi, une façon de dormir la nuit, de glisser instinctivement sa main sous l’oreiller comme quand on était enfant, un réflexe de survie, auquel s’accrocher au bord du puits.
…
L’exigence est une règle qu’on s’impose d’abord à soi, et moi, je balaie toujours devant ma porte.
…
Peu importe, c’est possible, il y a en moi un penchant romantique qui peut m’amener à réaliser des actes aussi saugrenus que conserver dans une vieille fiole la terre d’un endroit que j’ai aimé. Voilà le genre d’obhets, sans aucune valeur marchande, auxquels je suis capable de m’attacher, moins pour ce qu’ils renferment que pour ce qu’ils sont susceptibles de faire réapparaître sans crier gare, une image si bien enfouie que j’en ai oublié la cachette et l’existence. Une image pourtant bien nette, parfaitement conservée, comme si elle avait été soigneusement empaqueté dans des boîtes au grenier.
…
Alors j’ai pensé que même si très probablement je m’enfoncerais désormais dans une solitude de plus en plus implacable, ne connaîtrais peut-être plus jamais l’émerveillement splendide de l’état amoureux, le confort d’une vie à deux, j’avais dansé du crépuscule à l’aube en robe flamenca et bu du chocolat chaud au petit matin chez les gitans avant d’aller me coucher. J’avais joui dans les bras de plusieurs hommes. J’avais été reine, et belle, et puissante. Il m’avait toujours manqué quelque chose mais j’avais réussi parfois à toucher ce qui ressemble au bonheur, comme peuvent l’éprouver les gens comme moi, sur le départ. J’en avais quand même bien profité, certaines escales avaient duré, un peu.
…
Je crois que je leur fiche un peu la frousse, sans qu’ils réussissent à se l’avouer, et je suis bien obligée de me griser seule de mes victoires sans témoins. Victoires, précisément, parce que sans témoins. C’est le paradoxe et la limite de mon triomphe. Il n’existe que parce que personne ne le voit. Le jour où j’aurai un spectateur, mon règne s’achèvera. Je le redoute, je le souhaite. Je jouis de mon empire secret en espérant sourdement son renversement et mon entrée dans la lumière. Condamnée à l’humanité.
…
Ça marche à tous les coups, rien n’est plus enfantin que la rumeur.
…
Chaque jour je me demande quand va-t-on m’immobiliser et m’injecter un tranquillisant, un stabilisateur d’humeur, une bonne décharge électrique, quand vais-je en finir avec la tristesse. Pourquoi me laisse-t-on m’égarer au bout de ma peine, pourquoi ne m’arrête-t-on pas ?
…
Je connaissais bien aussi cette douleur de l’exclusion, pire encore, celle du coeur qui se brise et n’en finit pas de se briser, du coeur déjà en miettes et qu’on peut, aussi inconcevable et cruel que cela paraisse, réduire en morceaux toujours plus petits, car il faut de nombreux coups pour arrêter l’amour, il faut le tabasser à plusieurs reprises pour s’assurer qu’il ne bougera plus, au prix d’une souffrance qui n’est comparable à aucune autre. Et que celle-ci ait pu conduire Lorca Horowitz jusqu’à la folie où elle avait glissé m’épouvantait, non parce que je n’aurais jamais soupçonné que ce la fût possible mais, au contraire, parce que je l’avais toujours su.
…
J’ai connu le chagrin d’amour. Des hommes m’ont quitté. Il y a eu un moment, chaque fois, où j’aurais voulu mourir, où je ne croyais pas possible de survivre à la déflagration. Je n’étais pas morte, pourtant, j’avais jusqu’ici toujours réussi à rassembler mes morceaux, à réparer mon orgueil blessé. J’avais accepté la perte de l’homme aimé, et de la femme que j’avais été, désirée, caressée, dans ses bras. Parfois c’était vite passé, et je m’étais moquée plus tard de mes larmes et de mes insomnies qui, avec le recul, m’avaient semblé, dans le meilleur des cas, incompréhensibles. Parfois le prix avait été terrible. Quelque chose de moi avait dû périr, quelque chose qui ne serait jamais retrouvé et dont la disparition provoquait une douleur lancinante, comme un point de côté qui persiste alors qu’on a arrêté de courir. Puis j’avais recommencé.
J’avais eu envie de mourir mais rarement de tuer, même si l’idée a pu m’effleurer dans la rage de la jalousie, quand la blessure est si vive qu’elle fait faire et dire n’importe quoi et transforme une femme douce en furie, quand plus rien ne tient, de raison ou d’honneur, de dignité ou même de calcul, qu’on est livrée à la tyrannie de ses émotions qui déferlent en force, sans aucune hiérarchie.…
Il n’y a pas d’apaisement possible quand on aime passionnément un être qui vous trahit, quand on continue de l’aimer en dépit du mal qu’il vous fait.
…
J’ai toujours eu besoin de mouvement, de renouvellement. C’était sans doute le drame silencieux de mon existence, je courais après quelque chose d’insaisissable et, dans ce genre d’épreuve, généralement, on répand le malheur autour de soi. Ceux qui sont à vos côtés n’arrivent ni à vous immobiliser, ni à vous rejoindre. Je redoutais qu’une situation se fige. Très vite, dès que trop de confort s’installait, d’habitudes, je ne pouvais pas m’empêcher de changer les meubles de place. Il me fallait sans cesse réinventer le quotidien, définir de nouveaux projets, élargir l’horizon, modifier les repères, déménager. Je ne sais pas si les hommes qui m’ont aimée l’ont compris, s’ils ont perçu que cette guerre permanente n’était en aucun cas dirigée contre eux, mais ceux qui ont partagé ma vie en ont très certainement souffert. Ils se sont sentis déchoir peu à peu, impuissants à combler cette exigence qu’ils prenaient pour un reproche ou une accusation, un signe de désamour, la marque d’une insatisfaction grandissante dont ils auraient été à l’origine. Ils avaient l’impression de ne jamais être à la hauteur de mes attentes et ne le supportaient pas. Ils ne voyaient pas que ce n’était pas à eux que je cherchais à échapper, ni même à la répétition qui peut être su douce parfois, que j’ai savourée sans rougir et espère connaître à nouveau s’il m’est donné sur terre une autre chance. Je devais régulièrement partir, c’était plus fort que moi, fuir au-delà du périmètre de sécurité, et j’aurais tant voulu qu’un homme vienne avec moi. Mais ils m’ont quittée, tous, même le dernier, que j’avais cru mon âme sœur (…).
…
Plus elle exagérait, plus c’était invraisemblable, mieux ça passait. Elle avait dû en nourrir encore plus de déception, de dégoût et de rage envers l’humanité, s’était trouvée plus seule que jamais devant sa propre métamorphose, comme un triomphe devant une salle vide. Il n’était pas question de jubiler, de se frotter les mains de contentement avec un rire sardonique après le bon tour qu’elle avait joué à tous. Elle n’avait pas plus de spectateurs que lorsqu’elle était soubrette. Elle était riche et belle, et seule au monde. Les autres étaient des esclaves. La victoire avait un sale goût. Lorca était le dernière femme livre. Elle avait désormais le contrôle total du navire alors qu’il ne restait plus une âme à bord.
…
Dans les traversées houleuses que j’ai dû supporter, à différents âges de ma vie, mes enfants m’ont retenue du côté de la vie et la littérature m’a enveloppée. C’est une voix, une musique susceptible de surgir à n’importe quel moment, n’importe où.
…
Le bonheur avait existé, on me l’avait facturé au prix fort et j’aurais bien aimé savoir pourquoi. Certains jours, j’oubliais même jusqu’au souvenir de son relief, je n’éprouvais que son absence, il me manquait, même s’il m’avait coûté trop cher, j’étais ruinée. Il m’avait tout pris. Personne autour de moi ne s’en rendait compte (…). Dans l’art de sourire avec le cœur brisé, j’étais devenue une experte, moi aussi.
…
(…) le plus dur c’est le soir. La vérité, elle est là, c’est à cause du soir que j’ai décidé de prendre un amant, pour l’objectif qu’il représente, la lucarne dans le noir. Il y en a qui écrivent la nuit, on me l’a raconté, repoussant l’épuisement, les brumes de l’alcool, le désespoir qui tape plus fort à ces heures, fouillant jusque dans les retranchements insoupçonnés de leur endurance, ça les conserve intacts, comme dans la glace, même quand ils subissent la pire des journées, ils gardent à l’horizon ce phare qui, s’il n’est un rien un aboutissement, constitue au moins un repère. Mais je ne sais pas nager dans les seules satisfactions de la pensée. L’écriture rend paraît-il la solitude envisageable, on dit qu’elle est une force qui s’autosuffit, qui avance comme un train dans la nuit. En ce qui me concerne, je vais prendre un amant.
…
Pour mon malheur, je l’aime toujours, car l’amour est sans doute des sentiments le plus difficile à contrôler, et les femmes supérieures s’attachent souvent de manière incompréhensible à des êtres qui ne leur arrivent pas à la cheville et les font souffrir par complexe et dépit. L’amour est stupidement aléatoire, contrairement à l’estime, pur produit de la volonté.
…
Cela me troublait, même si c’était dans une certaine logique ou tradition littéraire, à laquelle n’échappaient pas les grands écrivains que je faisais étudier à mes élèves, qui veut qu’on se captive bien plus pour les assassins que pour les assassinés, à qui on attribue moins de mystère et simplement la déveine de s’être trouvés au mauvais moment au mauvais endroit, bref un rôle passif sur toute la ligne.
…
Ma vie telle qu’elle avait été ces dernières années était terminée. Qui serais-je la prochaine fois ?
Un grand merci aux Éditions Stock et à Netgalley pour m’avoir offert l’opportunité de découvrir ce livre en avant-première.
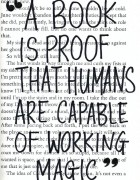
Premières chroniques de rentrée. Un sujet qui pourrait me plaire, un personnage et une auteure que je n’ai jamais lue.
J’aimeAimé par 2 personnes
Oui, et elles vont être nombreuses, j’ai été gourmande… Comme d’hab quoi ;)
Tu peux tenter celui-ci ou, si tu aimes les biographies, la très bonne qu’elle a écrite sur Marilyn Monroe : http://gwordia.hautetfort.com/apps/m/archive/2012/06/22/marilyn-monroe-par-anne-plantagenet.html :
J’aimeAimé par 1 personne
très belle chronique!
J’avais pourtant apprécié Là où tombe la pluie ainsi que Avant d’aller dormir.
Mais sur celui-là, il me manque quelque chose… Surtout une vraie fin je crois!
Ma chronique est ici: http://alombredunoyer.com/2015/12/30/appelez-moi-lorca-horowitz-anne-plantagenet/
J’aimeAimé par 1 personne
Merci beaucoup Benoît ! Je comprends ton sentiment. J’ai tendance aussi à ne pas être très friande de fins ouvertes mais en l’occurrence, je la trouve suffisamment claire et les réponses ou pistes me satisfont. Peut-être que c’est plus facile avec le sentiment d’identification qui, pour ma part, a été très présent… J’avais lu ta chronique mais je file me rafraîchir la mémoire ; et voir s’il y a du nouveau.
J’aimeAimé par 1 personne
J’avais commencé un livre de cette auteure et ça avait un abandon mais là, le sujet m’attire. Et la couverture est superbe!
J’aimeAimé par 1 personne
N’est-ce pas ! De mon côté, je n’avais lu qu’un titre d’Anne Plantagenet, sa très bonne biographie de Marilyn Monroe, que je te recommande par la même occasion : http://gwordia.hautetfort.com/apps/m/archive/2012/06/22/marilyn-monroe-par-anne-plantagenet.html
J’aimeJ’aime
Pingback: Dedans ce sont des loups de Stéphane Jolibert | Adepte du livre
Pingback: Rien que des mots d’Adeline Fleury | Adepte du livre
Pingback: Rien que des mots d’Adeline Fleury | Adepte du livre
Pingback: Bilan 2016 & vœux 2017 | Adepte du livre